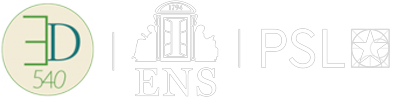Paris, 10–12 juin 2026, Institut historique allemand, Collège de France, Maison de
la recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Les chercheurs en début de carrière sont particulièrement invités à soumettre leurs propositions de
communications pour cette conférence interdisciplinaire consacrée au débat actuel autour des Lumières. La conférence se concentrera sur la problématique suivante: comment la recherche sur les Lumières historiques et les références ou critiques contemporaines aux Lumières se remettent-elles mutuellement en question?
Les propositions de communications, accompagnées d’une explication d’une demi-page sur le sujet, d’un bref CV et d’une classification dans l’une des trois sections ci-dessous, doivent être envoyées au président de l’ISECS/SIEDS avant le 26 octobre : daniel.fulda@germanistik.uni-halle.de
Les frais de déplacement et d’hébergement devraient être pris en charge par les organisateurs.
Les langues de la conférence sont le français et l’anglais.
Pourquoi ce colloque ?
Le SIEDS et la plupart de ses sociétés membres ont été fondées alors que, chez les chercheurs et peut-être davantage dans la société en général, la réputation du mouvement des Lumières issu du dix-huitième siècle était à son apogée: les penseurs des Lumières étaient des combattants pour la liberté de pensée et l’autodétermination, des défenseurs du progrès, des pionniers de la société démocratique. Bien entendu, les spécialistes savaient que cette vision des choses était idéalisée, mais elle se prêtait bien à l’essor des démocraties dans les sociétés occidentales et ailleurs, dans le dernier tiers du XXe siècle.
Au tournant du millénaire, cependant, les vents autrefois favorables aux Lumières soufflent dans d’autres directions. Aujourd’hui, on perçoit plus clairement que la société envisagée par les penseurs des Lumières était caractérisée par un certain nombre d’inégalités fondamentales: on remarque notamment un déséquilibre entre les sexes, entre le peuple et les élites, entre l’Europe et le »reste« du monde. Les représentants du discours post-colonial considèrent pour leur part que la pensée des Lumières, non seulement dans ses conceptions des races mais aussi dans sa promotion de la rationalité, sert avant tout à justifier la domination et l’exploitation européennes. De l’autre côté du spectre politique, la pensée des Lumières est également critiquée par ceux qui la voient comme une destruction arbitraire des traditions, ou encore comme l’auto-valorisation égoïste d’une petite élite intellectuelle. La situation actuelle peut être résumée par une variation sur le titre d’un livre bien connu: »Les Lumières contestées de nouveau« (Enlightenment contested again).
Cette évolution des choses pose un défi à quiconque étudie le XVIIIe siècle, à au moins deux titres. Premièrement, parce que cela concerne les conditions contemporaines de la recherche et son écho potentiel dans le grand public. Deuxièmement, parce que les spécialistes du XVIIIe siècle sont en mesure de contribuer de manière
substantielle aux débats actuels autour du rôle des Lumières dans l’histoire de l’humanité. En organisant le colloque »Reframing the Enlightenment / Le défi des Lumières«, la SIEDS souhaite répondre à ce double défi. L’enjeu est de réfléchir au contexte contemporain dans lequel nous effectuons nos recherches, et de prendre une position éclairée et documentée face aux représentations des Lumières dans les débats d’aujourd’hui. Les contributions devraient donc s’attarder à la fois aux objets historiques et à la compréhension des Lumières au présent. L’objectif du colloque est de dépasser l’alternative simpliste consistant à se positionner pour ou contre les Lumières, en mettant à la fois l’accent sur la complexité des Lumières historiques, et sur leurs héritages au présent et au futur.
Co-organisateurs, avec la SIEDS (représentée par son Président, Prof. Daniel Fulda, Halle): Institut historique allemand, Paris (Dr. Christine Zabel); Chaire d’Histoire des Lumières, XVIIIe–XXIe siècle, Collège de France (Prof. Dr. Antoine Lilti); Société française d’étude du dix‑huitième siècle (Prof. Christophe Martin); Bibliothèque Polonaise de Paris (Prof. Dr. Maciej Forycki); Prof. Florence Magnot-Ogilvy (Sorbonne Nouvelle); Prof. Dr. Chunjie Zhang (University of California, Davis)
Le colloque s’intéressera principalement aux questions suivantes :
I. Privilèges sociaux et exclusions: Qui profite des Lumières? Est-ce un problème qu’elles aient surtout été portées par de vieux hommes blancs? Ou cela n’est-il pas vrai du tout?
2. Comment concilier la reconnaissance de la critique postcoloniale et l’exploitation de l’héritage des Lumières pour l’épineuse question des migrations contemporaines et des droits humains qui y sont liés? Comment naviguer entre la demande de »provincialisation« de l’Europe et des Lumières et la possibilité de recadrer les Lumières pour une plus grande justice mondiale?
3. Questions épistémologiques: Les Lumières ont-elles réellement existé, ou ne furent-elles qu’une construction rétrospective, motivée par des intérêts politiques et trop volontiers soutenue par la recherche?
Le colloque se divisera ainsi en trois sections, brièvement décrites ci-dessous :
I. Les Lumières ont-elles fait la promotion de l’égalité ou de l’élitisme?
Les Lumières sont considérées comme le fondement de la démocratie moderne et libérale, particulièrement dans le grand public (Pinker), mais aussi par plusieurs chercheurs (Israel, Padgen). Songeons non seulement aux principes politiques des révolutionnaires en Amérique du Nord et en France, mais plus généralement aux valeurs défendues par les penseurs des Lumières dans d’autres pays, telles que le don de la raison, la dignité de l’individu, l’égalité devant la loi ou encore la tolérance religieuse. Cependant, avant les révolutions de part et d’autre de l’Atlantique, la réalité avait peu à voir avec ces idées, toutes les sociétés européennes étant fondées sur les ordres et la hiérarchie, c’est-à-dire non sur un principe d’égalité, mais plutôt d’inégalité sociale. L’ordre social dans lequel une personne naissait déterminait pour une large part ses chances dans la vie. Au surplus, plusieurs auteurs des Lumières cultivaient des habitus très élitistes, cherchant l’approbation des privilégiés et n’éprouvant le plus souvent que du mépris ou de la dérision envers les gens peu éduqués (Lilti). La plupart des protagonistes des Lumières semblaient ainsi très éloignés de l’idée suivant laquelle la société pouvait, et devait, être reconstruite afin que chacun puisse vivre une vie autodéterminée.
On accuse de plus en plus les Lumières, à bien des égards, d’avoir renforcé les hiérarchies sociales, voire d’en avoir créé de nouvelles. La gestion des affaires publiques était assignée seulement aux hommes, alors que les européens (ou du moins certains d’entre eux) se sentaient appelés à civiliser le monde dans son ensemble. Suivant cette perspective, la représentation historiquement acceptée des Lumières ne serait plus adéquate, ayant négligé sous plusieurs aspects l’idée d’égalité. L’anthropologie et la vision sociale des Lumières devraient ainsi être entièrement revues, dans la mesure où elles auraient été caractérisées par des hiérarchies privilégiant la rationalité, la masculinité, la »blanchité« et la propriété (Dhawan).
La recherche dix-huitiémiste peut répondre à cela de diverses manières. En premier lieu, ces critiques s’adossent souvent à une version lacunaire de l’histoire des Lumières, une représentation rationaliste, unidimensionnelle et orientée autour des »grands« penseurs masculins. Les chercheurs considèrent depuis longtemps cette perception comme dépassée, car elle néglige la diversité des positions développées par les penseurs des Lumières, qui varient de l’élitisme jusqu’à l’égalitarisme. Il est par ailleurs nécessaire de tenir compte du contexte historique. Il n’aurait pas été possible, pour les auteurs du XVIIIe siècle, de rendre justice aux idées d’équité et d’égalité telles que nous les concevons aujourd’hui, de sorte qu’il est anachronique de critiquer les Lumières à l’aune de ces valeurs actuelles. La connaissance historique ne consiste pas à reconnaître le présent dans le passé, mais à reconstruire le chemin qui relie l’un à l’autre. Ce que les Lumières du XVIIIe siècle ont »accompli« se mesure par les impulsions de changement qu’elles ont données à la postérité, et qui se prolongent encore aujourd’hui (Robertson).
Il importe cependant de considérer qu’il est difficile de relativiser les critiques des Lumières qui s’appuient sur un idéal d’égalité. Après tout, l’idée même »d’éclairer« n’implique-t-elle pas nécessairement une disparité entre les personnes à éclairer, et celles qui portent en elles un peu plus de lumière? L’émancipation présuppose un déficit de liberté, ainsi qu’un effort d’émancipation déjà amorcé, sans lequel ce déficit ne pourrait être reconnu, ni combattu. Bien qu’il serait réducteur de comprendre les Lumières comme une démarche inévitablement paternaliste (et ainsi la déclarer comme contradictoire), la différence entre savoir et non-savoir (ou, formulé plus prudemment, entre différents degrés de connaissance), c’est-à-dire un rapport inégalitaire, en constitue un élément fondamental. Si tel est le cas, on pourrait dès lors retourner la question aux critiques des Lumières, en leur demandant si elles ne se permettraient de critiquer que parce qu’elles se mettent elles-mêmes dans une position de supériorité.
Conséquemment, l’idéal au fondement de l’accusation selon laquelle les Lumières sont aux prises avec une variété d’inégalités mérite également une réflexion critique (McMahon). En effet, bien que l’idéal d’égalité soit perçu comme une quasi-évidence dans la modernité démocratique, il est lui-même source de contradictions. En témoignent les vifs débats dans les sociétés d’aujourd’hui, à savoir quelles inégalités devraient être priorisées: celles entre les hommes et les femmes, entre les riches sociétés du Nord et celles du Sud, ou encore entre les privilégiés et les marginalisés dans les pays, encore relativement prospères, où les Lumières ont émergé.
Les contributions autour de ces enjeux pourraient notamment aborder les questions suivantes:
– Sous quelle forme, ou selon quelles conditions, les protagonistes des Lumières ont-ils accepté, ou rejeté, les inégalités sociales?
– Y a-t-il un lien entre la critique des privilèges dans les sociétés européennes formulée par les Lumières, et le sentiment de supériorité des européens par rapport à d’autres parties du monde, qui se développe pendant et après le XVIIIe siècle?
– Dans quelle mesure les Lumières ont-elles été participatives ou autoritaires dans leurs réalisations pratiques? Les Lumières étaient-elles (surtout) l’oeuvre des élites?
– Quelle part »d’autorité pédagogique« les Lumières comprennent-elles inévitablement, non seulement à l’égard des enfants mais de manière générale? Quels en sont les dangers, les bénéfices potentiels?
– Comment la recherche universitaire, dont fait partie l’étude des Lumières, peut-elle réagir aux fortes attaques politiques dans les sociétés occidentales d’aujourd’hui, qui l’accusent d’arrogance élitiste? Comment défendre la volonté de générer et de transmettre la connaissance contre l’accusation suivant laquelle les élites universitaires projettent une image de supériorité intellectuelle pour se donner une position discursive avantageuse?
– Comment les Lumières devraient-elles être organisées afin d’avoir le plus grand impact possible dans le monde d’aujourd’hui? Quels sont les publics importants, les groupes sociaux à viser?
– Dans quelle mesure l’étude des Lumières est-elle inclusive? Quels sont les préjugés et les angles morts résultant du fait que ce champ d’étude a longtemps été majoritairement masculin et occidental, et l’est encore à bien des égards? Est-il possible de rectifier la situation?
Bibliographie sélective
Dhawan, Nikita, ed. Decolonizing Enlightenment: Transnational Justice, Human Rights and Democracy in a Postcolonial World. Leverkusen: Budrich, 2014.
Israel, Jonathan I. Democratic enlightenment: Philosophy, revolution, and human rights 1750–1790. Oxford: UP, 2012.
Lilti, Antoine. L’héritage des Lumières: ambivalences de la modernité. Paris: Seuil/Gallimard, 2019.
McMahon, Darrin M. Equality: The history of an elusive idea. New York: Basic Books, 2023.
Pagden, Anthony. The Enlightenment and why it still matters. Oxford: UP, 2013.
Pinker, Steven. Enlightenment now: The case for reason, science, humanism, and progress. London: Penguin, 2019.
Robertson, Ritchie. The Enlightenment: The pursuit of happiness 1680–1790. London: Allen Lane, 2020.
II. Les Lumières, la migration et la justice globale
»Pourquoi les nations échouent-elles?« C’est la grande question que posent deux lauréats du Nobel en économie (2024) dans leur influent livre sur le pouvoir, la pauvreté et la prospérité. Depuis la fin des années 1970, ces thèmes sont également au coeur de la critique postcoloniale et poststructuraliste. Alors que le XVIIIe siècle européen est une période charnière dans l’histoire coloniale, les Lumières sont devenues une ressource intellectuelle importante, aussi bien qu’une cible, pour les études postcoloniales et décoloniales, qui ont mis en évidence l’orientalisme et les inexactitudes de la représentation des cultures non-européennes dans la tradition intellectuelle occidentale. En particulier, les chercheurs ont interrogé l’héritage intellectuel des Lumières, à savoir comment, et dans quelle mesure, il a pu légitimer la démarche colonialiste et donner une caution philosophique à l’expansionnisme occidental et impérialiste en Afrique, en Asie, en Océanie et dans les Amériques. Emmanuel Kant, par exemple, a souvent été considéré comme l’inventeur de l’idée de race dans la pensée des Lumières et, à ce titre, comme le fondateur du racisme dans la philosophie moderne. Avec un ton moralisateur, la »couleur de la raison« semble catégoriquement redéfinir le programme des Lumières, passant de la rationalité, de l’universalisme et de la liberté au logocentrisme et à l’eurocentrisme. La démocratie, dès lors, ne semble réservée qu’aux élites dirigeantes et à leurs alliés. En même temps, l’insistance de Kant sur l’universalité de
l’éthique, ou sur la métaphysique de la morale, a par inadvertance établi les bases philosophiques de cette critique.
De plus, chez Kant, la compréhension de la téléologie dans le discours sur la race est intimement liée à la montée de l’historicisme, soit l’enseignement du développement des cultures et des nations d’un stade inférieur à un stade supérieur. Alors que l’historicisme est généralement associé à des penseurs du XVIIIe siècle tels que Voltaire ou Johann Gottfried Herder, ce dernier est aussi connu pour sa critique de la violence coloniale, de l’esclavage et de l’hégémonie. Il est toutefois indéniable que la pensée historiciste a gagné en importance à travers les penseurs des générations qui ont suivies, dont Georg Wilhelm Friedrich Hegel et Karl Marx. Encore à ce jour, elle constitue l’un des piliers de la pensée développementaliste qui caractérise l’économie politique à travers le monde. Les remises en question de la singularité des origines et de la hiérarchie historiciste par le poststructuralisme et le postcolonialisme posent un défi théorique à l’historicisme. Face aux défis et aux guerres contemporaines, nous réalisons qu’il y a encore des choses que nous devons accomplir, par-delà la déconstruction postmoderne. En effet, des aspects parfois négligés de la pensée des Lumières, concernant l’éthique, les devoirs (et les droits) humains, la théorie des climats, l’hospitalité, la sociabilité, le mouvement, l’âme et la spiritualité sont susceptibles de contribuer aux débats contemporains sur la démocratie, la migration et la justice. La force et l’énergie de la critique poststructuraliste et postcoloniale des Lumières dans les champs sociohistorique, philosophique et culturel pourraient être mobilisées dans une discussion plus large sur la migration et la justice dans un contexte mondial.
Les thèmes de la migration et de la justice abordés dans cette section devraient susciter de vives discussions sur l’héritage des Lumières et les défis de notre temps. Les conférenciers invités pour cette section pourraient être Lea Ypi, Jonathan Israel, Simon Gikandi ou Felicity Nussbaum.
Bibliographie sélective
Aravamudan, Srinivas. Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the Novel. Chicago and London: University of Chicago Press, 2012.
———. Tropicopolitans: Colonialism and Agency, 1688-1804. Durham and London: Duke University Press, 1999.
Berman, Russell A. Enlightenment or Empire: Colonial Discourse in German Culture. Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 1998.
Bernasconi, Robert. »Who Invented the Concept of Race? Kant’s Role in the Enlightenment Construction of Race.« In Race, edited by Robert Bersnasconi, 11-36. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.
Chakrabarty, Dipesh. »Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change.« New Literary History 43, no. 1 (2012): 1-18.
———. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
Eze, Emmanuel Chukwudi. »The Color of Reason: The Idea of Race in Kant’s Anthropology.« In Anthropology and the German Enlightenment, edited by Katherine M. Faull, 200-41. Lewisburg: Bucknell University Press, 1995.
Flikschuh, Katrin and Lea Ypi, ed. Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Gikandi, Simon. Slavery and the Culture of Taste. Princeton and London: Princeton University Press, 2011.
Golinski, Jan. British Weather and the Climate of Enlightenment. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
Judy, Ronald. »Kant and the Negro.« Surfaces 1 (1991): 4-70. http://philosophy.eserver.org/judy-kant.pdf.
Mignolo, Walter. Local Histories/Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton studies in culture/power/history. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
Mufti, Aamir R. Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and the Crisis of Postcolonial Culture. Princeton and London: Princeton University Press, 2007.
Muthu, Sankar. Enlightenment against Empire. Princeton and London: Princeton University Press, 2003.
Nussbaum, Felicity A., ed. The Global Eighteenth Century. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003.
Ranger, Eric Hobsbawm and Terence, ed. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Said, Edward W. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1993.
———. Orientalism. New York: Vintage Books, 1994.
Sikka, Sonia. Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Spivak, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
Thomas, Nicholas. Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge and London: Harvard University Press, 1991.
Wallerstein, Immanuel. European Universalism: the Rhetoric of Power. New York: New Press, 2006.
Withers, Charles W. J. Placing the Enlightenment: Thinking Geographically about the Age of Reason. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007.
III. »Les Lumières« ont-elles vraiment existé?
Des chercheurs ont récemment émis des doutes sur l’existence des Lumières. Parler de »Lumières«, avancent-ils, présuppose un mouvement cohérent qui tend vers des objectifs communs, alors que dans les faits, le XVIIIe siècle fut le théâtre d’idées réformatrices très différentes, souvent même discordantes, que la postérité aurait résumé sous le terme »Lumières«. Suivant cette perspective, il faudrait différencier les discours selon les pays, les langues, les dénominations, et sans doute aussi selon les corps professionnels et selon les genres, de sorte que nous ne pourrions, au mieux, parler que de »lumières« multiples (Pocock). De plus, le terme historique »Lumières« n’est devenu commun dans la plupart des langues qu’après la Seconde Guerre mondiale, répondant au besoin des démocraties occidentales de construire une préhistoire qui dépasse les cadres nationaux (Clark). Cependant, le terme doit une large part de sa fortune à son utilisation non-scientifique: parler avec bienveillance de »Lumières« peut agir comme un »symbole de supériorité morale«, de progressisme politique. Aussi, selon Clark, l’usage de ce terme, orné d’une majuscule, ne peut plus être destiné à une science qui se veut neutre et impartiale. Au contraire, il nous soumet à la tentation de projeter anachroniquement sur le XVIIIe siècle les valeurs politiques du temps présent, plus précisément celles du libéralisme occidental.
Cette critique s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement d’autoréflexion mené par la recherche dix-huitiémiste sur sa propre historicité, sur l’histoire et les discours autour du concept de Lumières (Ricuperati, Schmale, Coppola, Cronk/Décultot). Cependant, elle reprend également les techniques argumentatives de la »déconstruction« pour se donner une tournure conservatrice. La recherche dix-huitiémiste, même si elle se sent attaquée, ne devrait pas avoir une réaction allergique à ce phénomène, mais apporter une double clarification, qui concerne le contexte sociopolitique de la recherche ainsi que l’usage du langage au XVIIIe siècle. D’une part, il est important de réaliser, et d’expliciter, que la recherche s’inscrit effectivement dans un contexte où le terme »Lumières« suscite des associations hautement positives ou négatives, de sorte que le travail du chercheur, quelque soit la qualité méthodologique de la démarche, ne saurait faire abstraction des enjeux politiques. Il n’y a, d’autre part, aucune certitude historique selon laquelle les auteurs rétrospectivement désignés comme représentants des Lumières ne se soient eux-mêmes perçus comme contribuant à un mouvement qu’ils auraient pu nommer »les Lumières«, même s’ils ne le nommaient pas toujours ainsi. La recherche sur les termes, les images et les métaphores utilisées par les protagonistes des Lumières pour s’identifier auprès de leurs confrères, ou face à leurs adversaires, pose encore ses premiers jalons. À terme, elle
devrait permettre de jeter un nouvel éclairage sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, et sur le développement, qu’il soit plus ou moins cohérent, du mouvement des Lumières (Edelstein, Fulda).
Au XVIIIe siècle, le substantif anglais enlightenment renvoie encore au sens religieux (religious enlightenment), mais le verbe to enlighten et l’adjectif enlightened acquièrent graduellement un nouveau sens laïc et réformiste. Plusieurs autres langues européennes avaient un vocabulaire plus développé autour des Lumières, mais la recherche s’est surtout intéressée aux cas de l’allemand (aufklären, aufgeklärt, Aufklärung, Aufklärer) et du français (éclairer, éclairé, lumières, philosophe). Très tôt dans ce que nous connaissons aujourd’hui comme l’âge des Lumières, et parallèlement à l’émergence de ces mots, on retrouve l’idée suivant laquelle les gens vivent dans un temps nouveau, un âge »éclairé«. Déjà, en 1719, l’abbé Dubos évoquait les »lumieres que l’esprit Philosophique a répanduës sur nôtre siècle«. Malgré des différences parfois importantes, des approches réformatrices variées étaient perçues comme faisant partie d’un même mouvement, qui dépassait même les frontières nationales, par exemple chez Johann Christoph Gottsched. La synthèse d’éléments hétérogènes, dont on accuse le discours rétrospectif sur les Lumières, était en fait déjà présente dans le discours des acteurs de l’époque.
La recherche et les débats sur ces enjeux font notamment émerger les questions suivantes:
– À quels intérêts et tendances politiques l’étude des Lumières est-elle confrontée? Dans quelle mesure les points de vue politique et scientifique dépendent-ils l’un de l’autre?
– Quel degré d’enracinement dans l’usage historique est-il souhaitable pour les termes historiographiques? La légitimité d’une expression comme »les Lumières« dépend-elle de son utilisation par les acteurs de l’histoire? En présumant que ce ne soit pas le cas, quels seraient les bénéfices conférés au terme historique par son usage dans la période elle-même?
– À quel point le concept de »Lumières« peut-il être »élastique«? Quelle marge entre le sens actuel et le sens historique du terme est-elle tolérable?
– Comment envisager le fait que le vocabulaire clé des Lumières dérive de termes dont le sens à l’origine était partiellement, voire principalement religieux? Cela s’applique autant à enlignten et à lumières qu’à illuminato (italien), illustrado (espagnol), Verlichting (néerlandais) ou Просвещение Prosveshcheniye. Cette appropriation d’un vocabulaire et d’un répertoire visuel utilisés dans d’autres sphères, et en partie contre les Lumières elles-mêmes, peut-elle être comprise comme partie intégrante de la stratégie discursive des Lumières?
– Pourquoi le vocabulaire (et l’imaginaire) des Lumières s’est-il développé de manière si divergente dans différentes régions de l’Europe? Qu’est-ce que cela révèle-t-il à propos du caractère, des forces et des lacunes des Lumières dans les différentes sphères linguistiques?
Bibliographie sélective
Clark, J. C. D. The Enlightenment. An Idea and its History. Oxford: Oxford University Press, 2024.
Coppola, Al. »Enlightenolatry from Peter Gay to Steven Pinker: Mass Marketing Enlightenment and the Thick Eighteenth Century.« The Eighteenth Century 62 (2021 [2023]), 355–383.
Cronk, Nicholas, Elisabeth Décultot, ed. Inventions of Enlightenment since 1800. Concepts of Lumières, Enlightenment and Aufklärung. Liverpool: UP, 2023.
Delon, Michel. »Enlightenment, Representations of.« In: Encyclopedia of the Enlightenment, ed. by Delon. Vol. 1: A–L. Chicago: Fitzroy Dearborn 2001, 457–462.
Edelstein, Dan. The Enlightenment. A Genealogy. Chicago, London: University of Chicago Press, 2010.
Fulda, Daniel: »Identity in Diversity: Programmatic Pictures of the Enlightenment.« Journal for Eighteenth-Century Studies 45,1 (2022): 43–62.
Mortier, Roland. »Lumière« et »Lumières«, histoire d’une image et d’une idée. In id. Clartés et ombres du siècle des Lumières. Etudes sur le XVIIIe siècle littéraire. Geneva: Droz 1969, 13–59.
Pocock, J. G. A. Barbarism and Religion, vol. 1: The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1764. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Ricuperati, Giuseppe, ed. Historiographie et usages des Lumières. Berlin: Spitz, 2002.
Schmale, Wolfgang. Gesellschaftliche Orientierung. Geschichte der »Aufklärung« in der globalen Neuzeit (19. bis 21. Jahrhundert). Stuttgart: Steiner, 2021.
Schmidt, James. »Inventing the Enlightenment. Anti-Jacobins, British Hegelians, and the Oxford English Dictionary.« Journal of the History of Ideas 64 (2003): 421–443.